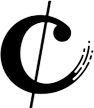Ligeti avait initialement projeté d’écrire une œuvre en un seul mouvement, faite de vingt-sept fragments enchaînés. Au cours du travail de composition, ce projet a été modifié. La version définitive comprend deux mouvements : le premier, lent et statique, est l’élaboration d’un seul des fragments ; le second regroupe les vingt-six autres, qui restent toutefois indistincts du fait de leur recouvrement partiel.
Le Concerto pour violoncelle s’organise donc en deux volets de durées égales, semblables par leurs dernières mesures, à la façon d’un distique librement rimé. La cadence du soliste qui clôt le second volet — « cadence chuchotée », elle se situe au plus loin du pathos des concertos traditionnels — est comme la version figurée de l’événement final du mouvement précédent : un fortissimo abrupt dévoile soudain l’abîme qui sépare les basses profondes du fragile suraigu tenu par le violoncelliste. Le compositeur a pu comparer ce dernier à un « funambule » : la conquête — toute silencieuse dans son vertige même — des harmoniques de plus en plus impraticables l’amène aux limites du possible.
Le second mouvement a également tout d’une « aventure instrumentale ». Mais, contrairement aux oeuvres vocales ainsi intitulées (Aventures et Nouvelles Aventures ont été composées respectivement en 1962 et 1965), ce n’est plus celle du (non) sens, mais celle d’un point de vue, d’une perspective : ce que Ligeti a appelé la « technique des fenêtres ». Un même paysage sonore qui défile, percé d’ouvertures qui ouvrent sur lui-même, ou sur d’autres percées qui à leur tour le dévoilent… (peut-on encore parler de « variations » ?). Dans cette aventure, un procédé cher au compositeur — et appelé à un développement important dans les oeuvres ultérieures — trouve sa place : la superposition en différentes strates de figures rythmiques asynchrones, à la façon d’un mécanisme de précision déréglé (comment ne pas songer au Poèmes symphonique pour 100 métronomes de 1962 ?).
Le premier mouvement, quant à lui, évolue dans l’atmosphère raréfiée si caractéristique de certaines pièces antérieures, celle précisément d’Atmosphères (1961). Une seule note — quand a-t-elle commencé d’exister ? — est imperceptiblement brouillée pour former un cluster ; dans le même calme, celui-ci conduit à une nouvelle immensité : un si bémol qui s’étend sur cinq octaves (c’est un tel espace qui ouvre la Première Symphonie de Mahler).
Peter Szendy